Fatima Parret, conseillère régional du Puy-de-Dôme, revient sur l’actualité du droit d’asile et les projets funestes du gouvernement.
Droit d’asile, un droit constitutionnel mis à mal ?
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de France par le nombre de demandeurs d’asile accueillis. Cela représente environ 12 000 personnes qui arrivent chaque année et confère aux politiques d’accueil et d’intégration une importance particulière sur notre territoire régional. Pour la France, on a enregistré 107 404 demandes d’asile en 2021 avec la moitié des demandeurs qui ont obtenu la protection internationale.
L’Europe compte en 2021, 535 000 demandeurs d’asile principalement des Syriens, Afghans et Irakiens.
Proportionnellement, dans le monde, en 2021, on compte 85,7 millions de personnes en situation de déplacement forcé dont 50,9 millions à l’intérieur des pays concernés et et 30,4 millions de réfugiés dans le monde, dont 3,7 millions en Turquie et 3,2 millions en Pologne.
Le droit d’asile en France…une attention de tous les instants…
Le droit d’asile est un des droits dont la législation est la plus sujet à modification, et ces multiples réformes rendent parfois difficile sa mise en œuvre.
Ce droit essentiel, gravé dans le préambule de notre Constitution connaît des changements réguliers. Plus de 15 réformes en une vingtaine d’années pour contrôler l’émigration en général et, qui, ont toujours réservé des changements sur le fonctionnement de l’asile.
Malheureusement ce n’est pas fini puisqu’une nouvelle réforme est en cours, discuté actuellement sans bruit et sera certainement votée dans un grand silence dans les prochaines semaines.
Nos dirigeants pratiquent un double discours, voulant à la fois garantir la notion de la France pays d’accueil, affirmer le droit d’asile, tout en conservant une certaine confusion entre asile et immigration. L’ambiguïté est renforcée par le fait que l’examen de la demande d’asile relève du ministère de l’intérieur alors que ce dernier a aussi une compétence en matière d’accès au territoire et au séjour. Et en matière d’expulsions.
Depuis le renforcement du contrôle aux frontières en 1993, et la complication de l’entrée en France, la demande d’asile devient une des seules voies d’entrée dans notre pays. Par conséquence, ce droit est parfois assimilé à une source d’immigration irrégulière d’autant plus que le statut de réfugiés ouvre des droits sociaux (prestations familiales, allocation logement, droit au minimum vieillesse et à l’allocation adultes handicapés, accès à la santé, à la scolarité, etc.) et que lorsqu’on est demandeur d’asile, on peut bénéficier d’une aide pour sa subsistance, d’une aide médicale et d’un hébergement en centre spécialisé le temps du traitement de la demande. Tout cela renforce le discours craintif d’un « détournement » du droit d’asile, et donc d’une méfiance chez le législateur qui mène ces multiples réformes.
Un parcours de plus en contraignant
Au nom de la lutte contre les demandes d’asile infondées, on rend difficiles les demandes légitimes d’asile depuis une vingtaine d’années.
On a créé des visas de transit même si les demandeurs d’asile ne changent pas d’aéroport lors de leur voyage d’exil, instauré des zones d’attente pour les étrangers non autorisés à pénétrer sur le territoire. Plus tard, on a renforcé encore les contrôles aux frontières, en instaurant, en ce qui concerne l’asile, les procédures prioritaires pour les demandes manifestement infondées. Puis on a diminué les délais de dépôt des demandes dès l’entrée sur le territoire et les délais de recours en cas de rejet d’une demande d’asile. Par une loi en 2003, on a instauré la notion de pays d’origine sûr qui tend à présumer du caractère infondé de certaines demandes d’asile de demandeurs originaires de pays où il n’y aurait pas de risques sérieux de persécutions (ce qui est contraire aux dispositions de la Convention de Genève en matière de non-discrimination des demandeurs d’asile selon le pays d’origine, convention ratifiée par la France au lendemain de la seconde guerre mondiale)…
Dix ans plus tard, en 2013, la loi introduit la faculté pour le demandeur d’être assisté par un avocat, réduit à neuf mois les délais de traitement d’une demande d’asile, permet un hébergement directif des demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire pour éviter des concentrations territoriales.
Face à l’afflux de migrants qui fuient les conflits notamment de Syrie et d’Irak, et à cause d’une difficile application de l’accord de Dublin (qui stipule notamment que le premier pays où le demandeur a présenté une demande doit l’examiner la demande d’asile), les Européens ont tenté, sans succès, de mettre en place des quotas. Cependant un nouveau pacte sur la migration et l’asile a pu être proposé pour harmoniser les pratiques entre les pays de l’union. Il reste beaucoup à faire. La question sépare les Européens, les divise…
Pendant ce temps, en France, on continue les réformes, et on raccourcit encore les délais pour le dépôt et le traitement des demandes d’asile. On continue à refuser le droit au travail aux demandeurs d’asile, les mettant en position de dépendance aux aides de l’Etat. On diminue les possibilités de recours en cas de rejet par l’Office OFPRA de la demande d’asile.
Un énième projet de loi
En mars 2023, un nouveau projet de loi est discuté, au même moment que la réforme de la retraite, ce qui éclipse les débats sur l’émigration et l’asile bien entendu.
La loi sera votée au sénat avec une procédure accélérée qui se termine prochainement. Elle ira ensuite à l’assemblée et sera définitivement adoptée avant l’été 2023. Sans surprise, cette nouvelle loi va durcir un peu plus l’accès aux droits des migrants en général et aux demandeurs d’asile en particulier. On va supprimer l’Aide Médicale d’État gratuite et ouverte à tous et la remplacer par une Aide Médicale d’Urgence payante et plus restrictive.
On va restreindre encore plus les possibilités de regroupement familial, conditionnés à une maîtrise minimale de la langue française pour les arrivants (en plus des conditions de ressources et des logements qui étaient déjà prévues). On va renforcer les expulsions d’étrangers sans papiers, qui seront considérés comme délinquants, et on va encore une fois réduire les délais de recours.
Avec l’asile en particulier et pour l’accueil des étrangers en général, nous devenons de plus en plus une forteresse. Le pays des droits de l’homme est plus préoccupé à restreindre le droit des plus précaires, les sans droits, les sans-papiers, les sans statuts, les sans revenus, les sans-abris…
On les criminalise, on les chasse, on ne veut plus les soigner et on s’en méfie…notre accueil est devenu un graal difficile à obtenir, à l’image d’autres pays européens qui ont fait du repli sur soi un art de vivre.
Le gouvernement a annoncé le 22 mars le report du projet de loi, mais nous devons restés vigilants.
Nous défendrons toujours l’accueil et le droit d’asile !
A la différence de l’extrême droite et de la droite extrême, qui veulent toujours plus de criminalisation, de restrictions pour l’entrée et le séjour des étrangers et qui préfèrent une France repliée sur elle-même, les écologistes préfèrent promouvoir une politique d’accueil digne et inconditionnel des réfugiés qui demandent notre aide.
Cette approche d’un pays accueillant, d’une société apaisée permettant la vie en commun de citoyens de toutes origines va à l’encontre du discours ambiant de rejet de l’autre et des promesses de l’expulsion de tous les sans-papiers.
Les écologistes pensent au contraire qu’il faut un travail d’inclusion des primo-arrivants par des programmes spécifiques pour connaître notre culture commune par exemple, et de régularisation de toute personne installée en France « justifiant d’un travail, d’une vie familiale ou d’enfants scolarisés ». pour qu’elle puisse travailler légalement et acquérir une stabilité administrative, familiale et financière. Cette régularisation permettrait de limiter au maximum la politique d’enfermement administratif des personnes en situation de précarité administrative et de mettre fin à l’automatique refoulement hors de nos frontières de sans-papiers, une pratique coûteuse, inefficace et inhumaine.
Pour les étrangers régularisés depuis plus de 5 ans, les écologistes défendent la possibilité pour eux de voter aux élections locales pour une intégration citoyenne réelle.
Les écologistes veulent préserver le droit d’asile et cela passe aussi par la mise en place des anciens visas de travail car nous avons besoin des travailleurs étrangers dans de nombreux secteurs.
Pour les mineurs étrangers non accompagnés, les écologistes proposent d’interdire la pratique contestée des tests osseux et pour les jeunes majeurs sans papiers, ils défendent une politique plus humaine d’automatisation de l’octroi d’un titre de séjour dès la fin de leur prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Enfin, plus globalement, les écologistes promeuvent une coopération décentralisée plus équitable et plus juste et des programmes de grande envergure pour lutter contre les causes de la misère, dont le dérèglement climatique qui est la cause de nombreux départs.


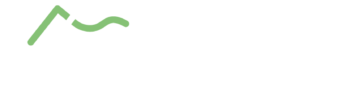
Que pensez-vous de l’externalisation du droit d’asile?